
Thiery Amélie & Pillot Hugo
Travaux Personnels Encadrés
Les rayonnements ionisants et leurs impacts
Qu'est-ce qu'un rayonnement ionisant ?
La radioactivité existe grâce à des noyaux instables qui subissent une transformation spontanée : un noyau père donne naissance à un noyau fils. Cette réaction correspond à l’émission d’une particule principale et peut-être accompagnée de rayonnements électromagnétiques. On parle aussi de désintégration. Un noyau fils peut être lui-même instable et donner lieu à une autre désintégration. Rappelons les notations concernant l’atome :
Où X est le symbole de l’atome concerné, A le nombre de masse (nombre de nucléons) et Z le nombre de protons. Le nombre de neutrons N vaut donc N=A-Z. Des isotopes d’un atome présentent des noyaux ayant un même nombre de protons mais un nombre différent de neutrons.
Les éléments instables qui se désintègrent en émettant des rayonnements ionisants sont appelés radionucléides.
Tous les radionucléides sont identifiés de façon unique par le type de rayonnement qu’ils émettent, l’énergie de ce rayonnement et leur demi-vie.
Pour mesurer l’activité des radionucléides, on utilise le becquerel (Bq): un becquerel correspond à une désintégration par seconde. La demi-vie est le temps nécessaire pour que l’activité d’un radionucléide diminue de moitié par rapport à sa valeur initiale. C’est aussi le temps requis pour que la moitié des atomes qu’il contient se désintègrent. La demi-vie peut varier d’une simple fraction de seconde à des millions d’années.
Différents rayonnements :
Le rayonnement gamma (γ)
Le rayonnement gamma est composé de photons de haute énergie. Ce rayonnement va pénétrer davantage dans l’organisme que les rayonnements alpha et bêta, mais il modifie moins les particules qu’il rencontre
Le rayonnement X
Le rayonnement X est formé de photons (particules composantes de la lumière). On utilise ce rayonnement pour observer à travers la matière (contrôle des bagages à l’aéroport, radiographie par exemple).
Les rayonnements X et gamma exercent sur les cellules dont se composent notre corps deux actions inverses : à dose très faible, ils les excitent ; à dose suffisante, ils ralentissent leur énergie vitale ou les tuent. Cette action modératrice ou destructrice du rayonnement du radium sur les cellules a trouvé en médecine des emplois dont le nombre augmente constamment. Le plus important, celui qui est au premier plan de l’actualité, consiste dans le traitement du cancer.
La radioactivité d’un élément est décrite par une équation du type :
X est le noyau père, Y le noyau fils et c la particule principale émise au cours d’une réaction nucléaire, il y a conservation de la charge électrique et conservation du nombre de nucléons (protons et neutrons).
3 types de radioactivité :
Il y a plusieurs types de radioactivité : α, β+, β-
-
La radioactivité α
La particule α correspond en fait à un noyau d’Hélium. Ce type de réaction concerne des noyaux lourds, instables à cause d’un excès de nucléons.
La réaction s’écrit alors :
-
La radioactivité β-
La radioactivité β- concerne les noyaux instables à cause d’un excès de neutrons et se traduit par l’émission d’un électron.
La réaction s’écrit alors :
-
La radioactivité + β
La radioactivité + β concerne les noyaux instables à cause d’un excès de protons et se traduit par l’émission d’un positon.
La réaction s’écrit alors :
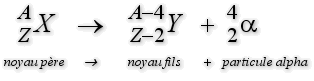
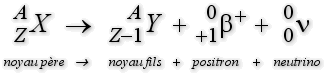
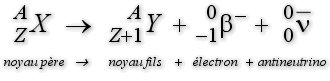

http://slideplayer.fr/slide/3547720/ (référence)
Page précédente / Page suivante